Le réemploi des matériaux de construction est une pratique en structuration depuis bientôt plus de 10 ans, mais avec quelle finalité ? Faire “comme avec du neuf” ?
A travers l’approvisionnement et la requalification des matériaux, nous verrons que la tentation de standardisation des process, comme des matériaux, recloisonne les dynamiques de conception, là où le réemploi est une opportunité de faire autrement, de travailler collectivement pour “savoir-faire”.
Se fournir en matériaux de réemploi n’est pas simple. Entre matériauthèques généralistes, diagnostics PEMD et fournisseurs spécialistes, les sources sont multiples. En explorant les forces et les faiblesses de ces modèles, nous verrons que la valeur du matériau, par les externalités qu’il implique, varie bien plus que son prix. Comment alors tendre vers une massification sans sacrifier la résilience et les impacts positifs des modèles existants ?
Au sein des équipes de maîtrise d'œuvre, un autre défi se pose : identifier un “qualificateur technique”. De plus en plus exigé par les assureurs, il certifie l’aptitude du matériau de réemploi à son futur usage. Contrairement à l’établissement d’une “chaîne de responsabilité”, cette nomination tend à faire porter la responsabilité à un individu omniscient, simplifiant l’identification de responsable en cas de sinistre. Quel impact cela a-t-il sur la façon de faire projet ?
Les bâtiments et les infrastructures qui constituent nos villes sont le site stratégique de l’accumulation des richesses. Ils témoignent pourtant sourdement de la violence extractiviste faite aux milieux naturels et aux populations souvent lointaines. Nous avons besoin de nouveaux récits pour repenser notre rapport à la matière nécessaire à l’établissement humain et non humain.
Le réemploi ouvre une des voies vers une architecture de la relation. Cette pratique tisse des liens autour de la matière glanée sur les territoires et autour de celles et ceux qui la font passer de main en main et la transforme formant des maillages collaboratifs locaux et situés.
Nous explorerons ensemble durant cette Bulle des pratiques de cueillette des matériaux de réemploi sur les territoires, des chantiers qui deviennent des lieux de transmission et du soin et enfin des processus de reprise des savoirs collectifs autour de l’assemblage ou la greffe de matériaux de récupération sur la ville existante.



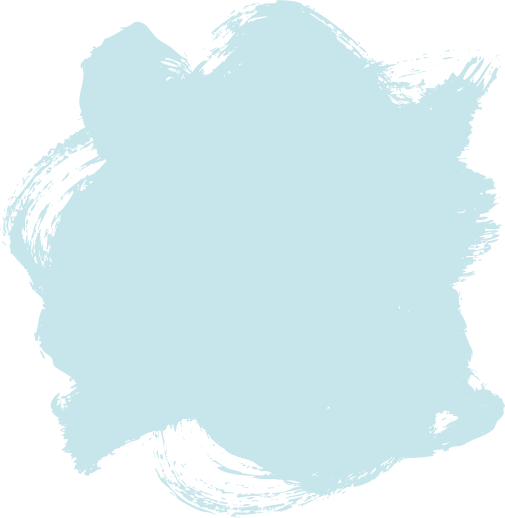
Pour cette 18e bulle, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux pionnières et ambassadrices du renouveau du réemploi au niveau local et national : Joanne Boachon, architecte et fondatrice de Minéka, l’une des 1ère plateformes de ressourceries « physiques » en France ; et Clara Simay, architecte et fondatrice de la Scop Grand Huit, une aventure humaine qui vient sceller un engagement au long court pour une architecture fortement ancrée dans les enjeux sociaux et écologiques des territoires.
« Comment, voyez-vous, au moment d’un concours d’Architecture le moyen de rassurer une MOA publique d’une part de la valeur du réemploi (sécurisation d’un prix) et d’autre part sur les défis de réemploi esquissé au moment du concours, mais non encore certains ? »
« Aujourd’hui, une multitude d’actions et d’acteurs complémentaires sont nécessaires pour déployer la chaine de valeur du réemploi. »
« Derrière la volonté de massifier, simplifier et désigner un seul responsable, se cache finalement la peur du réemploi, qui est parfois difficilement surmontable, qui pousse à normaliser, étiqueter… au-delà du raisonnable pour se rassurer à l’extrême afin de se désengager de toutes responsabilités. »
« En quoi consistent les ressourceries temporaires sur chantier ? »
« expérimenter, se laisser le droit à l’erreur, démarrer petit, sortir du marketing, se former, éviter la réplicabilité, et garder de la poésie dans sa pratique. »
« Savez-vous s’il existe une carte interactive recensant l’ensemble des ressourceries sur le territoire national ? »
« Se réinterroger sur les conséquences de l’extractivisme sur les milieux et sur les personnes, car nous sommes dépendant d’un système mondialisé. Il est raisonnable d’arriver sur d’autres façons de pratiquer. »
« Le bâtiment s’est beaucoup focalisé sur les questions énergétiques, et oublie la conséquence matérielle et des impacts sur nos milieux. »
« Comment se comportent les assurances décennales lors d’un sinistre si réemploi ? »
« Pensez vous que si la pratique se démocratise, le coût du réemploi sera accessible à un plus grand nombre de commanditaires (notamment privés) ? »
« Dans les petits projets, la question du réemploi ne peut-elle pas être portée par une maitrise d’œuvre formée et investie ? »
« Nous sommes à un moment charnière de résistance dans nos pratiques, vers quel contrat social tendons-nous ? Il faut remettre en selle l’intelligence collective et l’aléa et à une échelle locale, bref de tendre à la robustesse. »
« Comment concrètement répartir la responsabilité entre chaque acteur ? Est-ce que ça se matérialise par un contrat, une convention signée par tous les acteurs du chantier, est-ce que c’est plutôt l’obligation de chaque acteur de suivre une formation, une sensibilisation au réemploi ? Est-ce que vous auriez des exemples de cette responsabilité partagée dans un chantier ? »
« Pour anticiper au mieux le réemploi, à quel moment incluez-vous les artisans dans vos projets (notamment dans les marchés publics) ? Participent-ils déjà en phase conception ? »
Remettre du politique, de la relation à l’autre, du sens, et du projet commun … un propos presque iconoclaste mais salvateur en ces temps chagrins qui brouillent les messages …. faire ensemble et autrement, c’est possible, et ça fait du bien !
La pratique du réemploi peut être réjouissante et réhabilite notre humanité et notre rapport aux choses. “Agir dans la robustesse pour une biorégion solidaire” : des sujets forts qui nous parlent d’autant que la Scop les 2 Rives est en construction d’un Institut, fédérateur et d’un réseau et d’idées fortes qui grandissent depuis 20 ans #DDQE…à suivre !
Cycle de Bulles des 2 Rives « S’affranchir »
